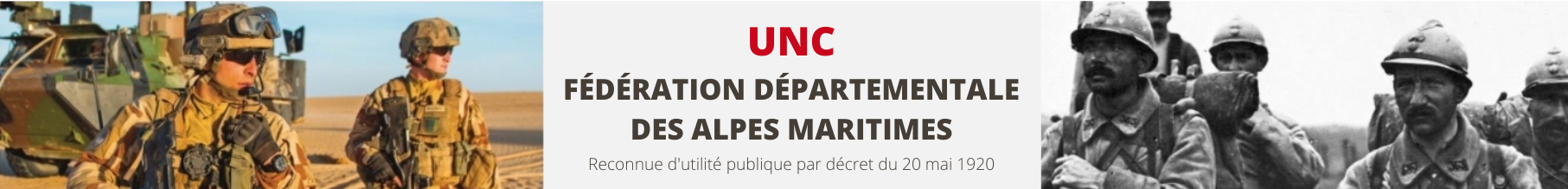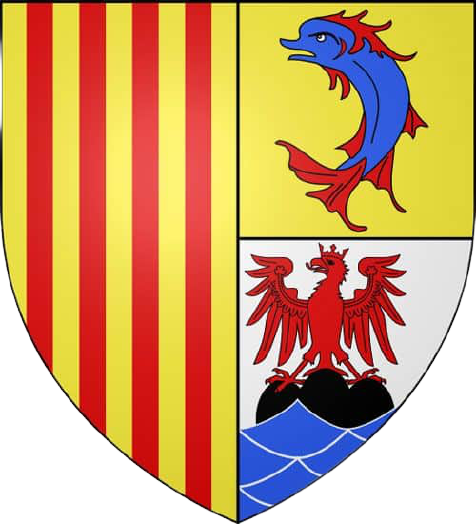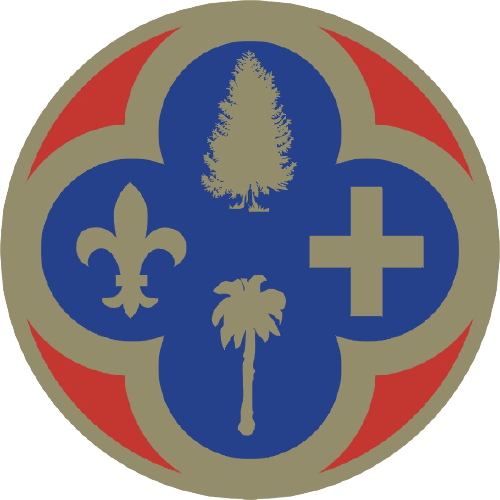L’US NAVY ECARTE LOCKEED-MARTIN DE SON PROGRAMME
L’US Navy écarte Lockheed-Martin de son programme de chasseur embarqué F/A-XX
par Laurent Lagneau
Alors que la Chine a fait voler deux démonstrateurs d’avions de combat de 6e génération, l’US Air Force s’interroge sur le sort qui sera fait à son programme NGAD [Next Generation Air Dominance], qui vise à développer un nouveau chasseur-bombardier associé à des drones de combat [UCAV] et à des effecteurs connectés.
Celui-ci a été mis en pause l’an passé, le secrétaire de l’US Air Force, qui était alors Frank Kendall, ayant expliqué qu’il s’agissait de voir comment réduire les coûts de développement, d’acquisition et d’exploitation, sachant que le prix unitaire de cet avion de 6e génération pourrait s’élever à « plusieurs centaines de millions de dollars ». Aussi, l’avenir du NGAD est désormais dans les mains de l’administration du président Trump.
En attendant, pour l’US Air Force, la poursuite de ce programme est indispensable pour lui permettre d’obtenir la supériorité aérienne dans les environnements fortement contestés. C’est en effet ce qu’a souligné l’un de ses responsables, à savoir le général Joseph Kunkel, lors de l’AFA Warfare Symposium, qui s’est tenu à Aurora [Colorado], entre les 3 et 5 mars.
« Pour être franc, lors d’une étude, nous avons testé tout un tas d’options différentes. Et elle nous a montrés qu’il n’y avait pas d’option plus viable que le NGAD pour obtenir la supériorité aérienne dans cet environnement hautement contesté », a-t-il en effet déclaré.
Pour rappel, Boeing et Lockheed-Martin sont en lice pour développer le NGAD, Northrop Grumman ayant préféré jeter l’éponge… Sans doute pour mieux se concentrer sur le développement du F/A-XX, un avion de 6e génération destiné à l’US Navy.
En effet, contrairement à l’US Air Force, cette dernière considère que la mise au point d’un avion de combat embarqué de 6e génération est une priorité, dans la mesure où elle entend remplacer ses F/A-18 Super Hornet et ses E/A-18 Growler de guerre électronique dans les années 2030.
En octobre dernier, le chef des opérations navales [CNO], Mme l’amiral Lisa Franchetti, avait indiqué que trois industriels s’étaient mis sur les rangs pour le F/A-XX, à savoir Lockheed-Martin, Northrop Grumman et Boeing. Et de préciser que l’examen de leurs offres étaient en cours.
L’US Navy n’a pas encore livré son verdict… Mais, selon Breaking Defense, Lockheed-Martin a été écarté, sa proposition n’ayant pas été jugée satisfaisante au regard des exigences du programme, dont on ne sait que très peu de chose, si ce n’est que le F/A-XX sera au centre d’un « système de systèmes » appelé FoS [pour Family of Systems] et qu’il devra être en mesure d’emporter des armes de longue portée ainsi qu’une panoplie de capteurs passifs et actifs. Enfin, il devra avoir un rayon d’action plus important et une vitesse plus élevée que les actuels F/A-18 Super Hornet.
En tout cas, Northrop Grumman est, a priori, relativement confiant. En 2021, sa PDG, Kathy Warden, avait en effet défini les conditions de sa participation à l’appel d’offres relatif au F/A-XX. « C’est un programme que nous poursuivrons si le gouvernement équilibre correctement les risques et les récompenses et si nous sommes bien positionnés », avait-elle dit.
Le ministère américain des Anciens combattants annonce réduire ses effectifs de 15%
par Philippe CHAPLEAU
Plus de 70 000 postes au ministère américain des Anciens combattants, l’un des plus importants en nombre de fonctionnaires, vont être supprimés, a annoncé mercredi le ministre Doug Collins, dans le cadre des coupes claires voulues par Donald Trump dans l’appareil fédéral.
« Notre but est de ramener les niveaux d’emploi au ministère des Anciens combattants à ceux de 2019, soit environ 398 000 employés – en comparaison de nos niveaux actuels de 470 000 employés », a déclaré le ministre dans un communiqué vidéo, donnant une estimation des effectifs actuels inférieure aux chiffres communiqués par le ministère le mois dernier.
Doug Collins justifie la mesure par le besoin de services « plus efficaces, à même de rendre des comptes, et transparents ». Ces coupes dans les effectifs se feront « sans effectuer de coupes dans les soins ou allocations aux anciens combattants », a-t-il aussi assuré.
Le syndicat AFGE de fonctionnaires fédéraux, qui revendique être la première organisation syndicale au ministère des Anciens combattants avec 311 000 membres (sur ses 800 000 membres au total), a dénoncé un plan qui « détruira la capacité » du ministère à « remplir ses promesses » envers les anciens soldats. Selon son président, Everett Kelley, le ministère est déjà « en sous-effectifs depuis de nombreuses années » et un tel « pillage » selon lui, « ne peut qu’empirer la situation ».
« Jusqu’à l’arrivée d’Elon Musk et Donald Trump, l’Amérique n’avait jamais tourné le dos à ses anciens combattants et à leurs familles », a-t-il ajouté
Vers un Jaguar pleinement opérationnel en 2025
par Nathan Gain
Épreuve réussie pour le Jaguar, qui aura atteint toutes ses cibles ce mardi en présence des 11 délégations étrangères rassemblées au camp de Canjuers (Var) pour des « Scorpion Days ». Un engin blindé de reconnaissance et de combat dont la pleine capacité opérationnelle devrait être atteinte cette année.
À l’arrêt ou en mouvement sur cible fixe ou mobile : le canon de 40 mm du Jaguar aura résonné à plusieurs dizaines de reprises sur le pas de tir des Amandiers. Derrière l’opération séduction pour les prospects étrangers, la séquence démontrait aussi la maturité atteinte par le successeur de l’AMX 10RC, dix ans après la notification du marché EBRC au trio KNDS France-Thales-Arquus et moins de trois ans après l’arrivée des premiers exemplaires au 1er régiment étranger de cavalerie.
Le développement du Jaguar reste un chantier en cours. Après la version R2 présentée à Canjuers, le troisième et dernier standard est désormais en cours de qualification industrielle. La qualification étatique se poursuit elle aussi, avec un léger décalage. Le tout devrait abouti cette année à une version pleinement opérationnelle « ouvrant le domaine » concernant l’Akeron MP, ce missile antichar complémentaire du canon et tiré d’un lanceur escamotable intégré sur la tourelle.
Complexe dans son développement, le lancement de l’Akeron MP a été l’objet d’une nouvelle campagne conduite en février à Bourges sur le site de DGA Techniques terrestres. Trois tirs y ont été réalisés : l’un d’urgence à 300 m, un second à 2500 m sur une cible mobile et un troisième à 3800 m et hors de la vue directe (TAVD), également sur cible mobile. Trois tirs, autant de coups au but et un nouveau jalon franchi visiblement sans anicroche.
L’exemple du Jaguar est significatif de la démarche incrémentale privilégiée pour le programme SCORPION, tous objets confondus. Deux incréments d’ensemble se sont déjà matérialisés, le deuxième exploitant notamment les retours d’expérience des premiers tours de roue du Griffon en opération extérieure. Le troisième est en cours d’écriture. Il amènera de nouvelles améliorations, dont de potentielles briques d’intelligence artificielle utiles pour la fonction de détection-reconnaissance-identification (DRI) ou une capacité TAVD de l’Akeron MP renforcée par le tir sur coordonnées. Sans oublier les RETEX de l’Ukraine, forcément appelés à alimenter les réflexions.
Fin 2024, l’armée de Terre avait réceptionné près d’un tiers des 300 Jaguar attendus à horizon 2035. Elle en recevra 33 de plus cette année. La Composante Terre belge attend ses premiers exemplaires en 2026, certains allant in fine armer le bataillon de reconnaissance binational pour lequel le Grand-Duché de Luxembourg prévoit quant à lui l’achat de 38 Jaguar. Et l’intérêt d’autres pays est palpable.
Guerre en Ukraine : les Français sont-ils prêts à suivre Macron en Ukraine ?
par Axelle Ker
Alors que la guerre entre dans sa troisième année, l’idée d’un engagement militaire européen en Ukraine a refait surface suite à la rencontre houleuse entre Volodymyr Zelensky et Donald Trump. Une proposition conjointe qui a été évoquée par Emmanuel Macron et son homologue britannique Keir Starmer dimanche 2 mars 2025. Mais qu’en pensent les Français ? Le CSA y répond dans son dernier sondage pour Europe 1, CNews, et le JDD, publié mardi 5 mars.
Troupes en Ukraine : la majorité des Français est contre
Les Français restent majoritairement opposés à l’envoi de troupes en Ukraine, mais leur désapprobation à cette éventualité a diminué par rapport à 2023. Selon le dernier sondage CSA pour Europe 1, CNews et le JDD, en effet, 65 % des Français rejettent toujours cette option, contre 76 % en 2023. Une baisse de 11 points en deux ans, qui témoigne d’une certaine évolution progressive des mentalités, bien que cette option soit encore largement rejetée par une majorité de Français.
Les plus jeunes affichent les plus grandes réticences : 76 % des 18-24 ans s’opposent à un déploiement français en Ukraine. Ce taux chute à 58 % chez les 25-34 ans, traduisant une ouverture plus marquée dans cette tranche d’âge. Chez les 50-64 ans et les plus de 65 ans, l’opposition est respectivement de 64 % et 62 %.
Les écarts sociaux sont également notables : 68 % des employés et ouvriers (CSP-) rejettent l’idée d’une intervention militaire en Ukraine, tandis que celle-ci concerne 60 % des cadres et professions intellectuelles supérieures (CSP+).
La réponse des répondants est encore plus marquée selon leurs affinités politiques : 87 % des sympathisants du Rassemblement National (RN) rejettent l’idée d’un envoi de troupes, tandis que 67 % des Républicains (LR) y sont également opposés. À gauche, les écologistes (EELV) et La France Insoumise (LFI) s’y opposent respectivement à 53 % et 58 %, tandis que les électeurs du Parti socialiste (PS) sont plus divisés, avec 49 % d’opposition. À l’inverse, 53 % des électeurs de Renaissance, le parti présidentiel, soutiennent l’envoi de troupes, ce qui en fait le seul électorat à apporter un soutien majoritaire à la proposition franco-britannique.
Un sommet pour accélérer le réarmement de l’Europe
Malgré ces réserves, Emmanuel Macron maintient sa ligne interventionniste. Lors de son allocution du 5 mars 2025, le chef de l’État a insisté sur la nécessité de renforcer les capacités militaires françaises et européennes en déclarant que « la menace russe est là (…) La Russie est devenue une menace pour la France et pour l’Europe ».
Le président français prévoit une augmentation du budget de la Défense, qui passerait de 3 % à 3,5 % du PIB. En parallèle, Bruxelles accélère aussi son réarmement : Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, souhaite lancer un plan de 800 milliards d’euros pour la défense européenne, c’est-à-dire pour moderniser les forces armées des pays membres et réduire leur dépendance aux États-Unis.
Les 27 pays membres de l’Union européenne se réunissent ce jeudi 6 mars 2025 dans le cadre d’un sommet exceptionnel sur la défense du Vieux continent et l’aide à l’Ukraine. À cette occasion, Emmanuel Macron souhaite lancer un débat stratégique sur l’avenir de la dissuasion nucléaire française, le but étant d’ouvrir des discussions sur une éventuelle extension de la protection nucléaire française à l’échelle européenne.
La défense française en 2025
par Alain RODIER
Un ancien haut diplomate qui a été ambassadeur de France, en Israël puis aux États-Unis, écrit sur X : « L’Europe assiégée ». Le ton catastrophique adopté provoque la question suivante : par qui ?
Dans son intervention télévisée du 5 mars, le président Emmanuel Macron s’est fait plus précis : « La menace russe est là, et touche les pays d’Europe. La Russie a fait du conflit ukrainien un conflit mondial en violant les frontières, manipulant l’information, les opinions (…) Qui peut croire que la Russie d’aujourd’hui s’arrêtera à l’Ukraine ? Elle est devenue une menace pour la France et pour l’Europe. »
Certes la situation mondiale est chaotique et les évolutions à venir sont imprévisibles – les analystes n’ayant jamais rien prévu de correct -, mais à priori personne ne veut aujourd’hui envahir l’Europe.
Qu’en est-il de la menace russe ?
Il est vrai que Moscou lorgne sur les pays baltes qui commandent l’accès à l’enclave de Kaliningrad considérée comme vitale par le Kremlin, un peu comme le port de Sébastopol en mer Noire. Enfin, toujours traumatisée par l’Histoire de la Seconde Guerre mondiale et 45 années de servitude, la Pologne continue à fantasmer le danger que la Russie ferait peser sur elle. Il y a également le problème de la Transnistrie qui souhaite son détachement de la Moldavie pour rejoindre la Russie.
Bien logiquement les dirigeants de ces pays en appellent à la solidarité de l’OTAN (les États baltes et la Pologne en sont membres et peuvent bénéficier de l’article 5) et de l’Europe car ils savent que la Russie – malgré les grandes déficiences de son armée constatées lors de l’« opération militaire spéciale » menée en Ukraine – peut les agresser et qu’il leur sera impossible d’y répondre seuls – d’autant que les pays baltes ont des armées lilliputiennes.
Si Moscou décide de passer à l’action, cela risque plus de ressembler à la conquête de la Crimée par les « petits hommes verts » en 2014 qu’à une offensive généralisée de grande ampleur. En effet, la Russie peut compter sur les populations russophones et russophiles nombreuses dans ces États (sauf pour la Pologne) pour lui apporter leur soutien du type « cinquième colonne. »
Mais une fois énoncées ces problématiques, il n’en reste pas moins que l’armée russe n’a ni la puissance ni la volonté d’envahir l’Allemagne, la France, ni d’autres pays européens.). La Russie n’est pas l’URSS d’autrefois et, en dehors de sa puissance nucléaire, elle n’a pas les moyens humains et matériels pour constituer une menace classique pour la vieille Europe – ni d’ailleurs la volonté. Qu’est qu’elle ferait de ces pays et de leyr citoyens pour le moins « ingérables » ?.
Au demeurant, durant la Guerre froide, la puissance militaire de l’URSS et du Pacte de Varsovie avaient été volontairement surévaluées par les Américains pour des questions de présence en Europe de l’Ouest. Bien sûr, elles n’étaient pas négligeables mais la « fable » des chars russes atteignant les côtes atlantiques de l’Europe en trois jours a été de mise jusqu’à ce que les faiblesses de l’Armée rouge n’aient été dévoilées lors de la guerre en Afghanistan (1979-1989) : matériels rustiques mais dépassés, valeur combative de la troupe sujette à caution, encadrement insuffisant, corruption endémique, etc.
Toujours est-il que la situation globale est très instable et la menace peut venir de là où ne l’attend pas. Il faut donc consacrer plus de moyens à la défense mais en déterminant une priorité dans les menaces.
La menace intérieure
La menace est d’abord intérieure, provenant des nombreux activistes de toutes tendances – et plus particulièrement ceux qui se revendiquent du salafisme/djihadisme – qui n’attendent que l’occasion e passer à l’action.
Les forces de sécurité intérieures doivent être beaucoup plus nombreuses et bien formées et disposer d’un renseignement adapté. Leurs unités (gendarmerie mobile, CRS, groupes d’intervention spécialisés) doivent être bien réparties sur le territoire pour pouvoir intervenir le plus rapidement possible afin d’empêcher qu’une situation violente ne dégénère en insurrection.
Des mesures ont déjà été prises avec la « recréation » la montée en puissance des anciens RG (Direction nationale du renseignement territorial/DNRT), l’implantation des d’antennes du GIGN en région, etc. Il convient encore de renforcer les effectifs de la gendarmerie et de la police et de développer une réserve opérationnelle plus active.
La menace sur l’Europe
Il n’y a pas de corps blindé-mécanisé russe prêt à fondre sur les pays de l’Union européenne, ni de forces de quadrillage pouvant être déployées pour le contrôle des terrains conquis comme du temps du Pacte de Varsovie. S’il y a une menace conventionnelle, elle est surtout aérienne. La défense de l’espace aérien ne commence pas aux frontières de l’hexagone. Elle devrait être intégrée au niveau européen, ce qui est déjà grandement le cas.
En revanche, il existe des affrontements d’influence – en particulier grâce à la guerre cybernétique – où les amis d’hier peuvent être les adversaires du jour. S’il y a eu une prise de conscience des autorités l’insuffisance de moyens humains et techniques est toujours d’actualité.
La menace sur l’Europe est donc totalement hybride et peut alimenter les mouvements activistes intérieurs. D’où l’importance de renforcer la défense des points sensibles comme les centrales nucléaires contre des actions de type terroriste pouvant être menée par tout idéologue radicalisé.
Par ailleurs, la guerre est aussi économique et a besoin de renseignements. Il convient de développer donc les services d’acquisition du renseignement offensif et le contre-espionnage défensif, bien que beaucoup d’efforts dans ces domaines aient été consentis ces dernières années.
Les menaces hors d’Europe
Hors d’Europe, la principale menace concerne les voies de circulation maritime par lesquelles passent nos approvisionnements et nos possessions ultramarines.
Là, ce sont les frégates multi-missions qui manquent ainsi que des moyens aériens projetés à l’extérieur (un nouveau porte-avions pourrait être utile.). Pour élargir le rayon d’action de la Marine, les drones aériens navalisés doivent être considérablement développés.
La Russie constitue un redoutable adversaire hors d’Europe – comme cela a été constaté sur le continent africain – et dans les territoires d’outre-mer, parfois via des pays tiers comme l’Azerbaïdjan. Mais les dangers à venir pourront venir d’autres acteurs comme la Chine en mal d’expansion. Il ne faut pas oublier non plus les États-Unis qui sont de redoutables prédateurs économique.
La dissuasion nucléaire
La dissuasion nucléaire reste l’ultime garde-fou qui assure l’indépendance de la France et garantit sa place de membre permanent au Conseil de Sécurité. Bien sûr, le flou doit être maintenu concernant les conditions d’emploi afin qu’un adversaire éventuel ne puisse penser les contourner.
Il convient aussi de conserver les deux composantes : l’une aéroportée, pouvant servir aussi pour une éventuelle frappe de « dernier avertissement » et l’autre sous-marine pour déclencher « ‘l’apocalypse. ». L’arme aéroportée (actuellement le missile de croisière air-sol moyenne portée amélioré ASMP-A) n’est en aucun cas une arme « tactique » destinée à emporter une décision sur un champ de bataille. Elle fait partie de la doctrine stratégique de la France.
En Europe, les Britanniques ne sont pas libres de mettre en œuvre les armes nucléaires stratégiques embarquées sur leurs SNLE sans l’autorisation de Washington. Par ailleurs, ils n’ont plus d’armes aéroportées. Les bombes nucléaires B-61 armant certaines forces de l’OTAN (Allemagne, Pays-Bas, Belgique, Italie, Turquie) ne sont destinées qu’à un emploi stratégique et le décideur final reste Washington. La question qui s’est toujours posée est : les États-Unis sont-ils prêts à sacrifier des villes américaines pour tenter de sauver l’Europe ? Le général de Gaulle était persuadé du contraire d’où sa décision de développer une force de frappe totalement indépendante.
Dans le domaine nucléaire, la menace est constituée par tous les pays qui la détiennent ou qui pourraient l’avoir. Il est donc essentiel de moderniser en permanence la force de dissuasion pour qu’elle reste « crédible. »
Tout cela coûte cher. Les responsables politiques doivent donc faire des choix. Plus on dépense pour la défense (intérieure et extérieure), moins on en fait pour l’action sociale, ce qui risque de poser des problèmes sociétaux générateurs de désordres intérieurs, pouvant être exploités ou initiés par des adversaires étatiques étrangers. C’est le serpent de mer qui se mord la queue…
L’École française de guerre économique vue d’Italie
par Giuseppe GAGLIANO
La recherche française sur les questions stratégiques – qu’il s’agisse de géopolitique, de guerre économique ou de renseignement – est souvent perçue comme l’une des plus dynamiques et rigoureuses d’Europe. Elle se distingue par une approche qui mêle héritage historique, pragmatisme et adaptation aux nouvelles réalités du monde multipolaire.
Historiquement, la France a toujours eu une pensée stratégique solide, héritée de figures comme Castex, De Gaulle ou encore Aron. Elle est toujours vivante aujourd’hui, contrairement à l’Italie ou même à l’Allemagne, qui ont parfois laissé leur réflexion stratégique être dominée par des paradigmes extérieurs (anglo-saxons ou européens), la France a maintenu une approche souveraine de ces questions, notamment en matière de renseignement et de protection des intérêts économiques.
Une réflexion novatrice sur la guerre économique
Ce qui frappe dans la recherche stratégique française contemporaine, c’est sa capacité à structurer un discours cohérent sur la guerre économique, alors que de nombreux pays européens ont longtemps refusé d’admettre l’existence même de ce phénomène. Contrairement à d’autres traditions académiques, souvent dominées par des analyses purement théoriques, l’École française de guerre économique se démarque par sa volonté d’être un outil concret au service des intérêts stratégiques nationaux.
Ce qui retient particulièrement l’attention dans la démarche française, c’est cette capacité à penser la guerre sous toutes ses formes – militaire, économique, informationnelle – sans cloisonnement artificiel. Dans cette optique, des penseurs comme Christian Harbulot ont joué un rôle majeur dans l’élaboration d’une véritable doctrine française de la guerre économique, inspirée des pratiques anglo-saxonnes, mais adaptée à la spécificité du système français et européen.
L’originalité de cette approche tient à plusieurs éléments :
– une reconnaissance précoce du fait que la guerre économique est une continuation de la guerre par d’autres moyens et que les États, mais aussi les entreprises, doivent adopter des stratégies défensives et offensives ;
– une analyse qui ne se limite pas aux rapports entre États, mais qui intègre pleinement les entreprises, les multinationales et les acteurs non-étatiques comme des participants actifs dans les affrontements économiques ;
– une prise en compte de la dimension informationnelle et cognitive de la guerre moderne, où l’influence et la manipulation de la perception jouent un rôle aussi déterminant que la force brute.
À cet égard, l’École de Guerre Économique (EGE), fondée par Christian Harbulot, représente un cas unique en Europe. Cette école a permis de formaliser un savoir-faire en intelligence économique, en veille stratégique et en protection des entreprises nationales, en mettant en avant l’idée que la puissance ne se joue plus seulement sur le champ de bataille, mais aussi dans l’arène économique et informationnelle.
En Italie, l’équipe du Centro Studi Strategici Carlo De Cristoforis (CESTUDEC) a prolongé cette réflexion en insistant sur les techniques d’ingérence économique, la guerre de l’information et l’importance des stratégies asymétriques utilisées par les grandes puissances. Son travail a notamment contribué à diffuser en Italie une vision plus réaliste et plus pragmatique des dynamiques de conflit dans l’économie mondiale.
Une approche offensive et défensive de la guerre économique
Ce qui différencie véritablement la démarche française, c’est son refus du fatalisme et son insistance sur la nécessité d’une posture offensive en matière de guerre économique.
Sur le plan défensif, la France a compris que les entreprises nationales et les infrastructures stratégiques sont des cibles permanentes de puissances étrangères, contrairement à d’autres pays européens qui ont longtemps ignoré ce danger, Paris a mis en place un arsenal juridique et stratégique pour protéger ses secteurs clés (défense, énergie, haute technologie) :
– renforcement des mécanismes de contrôle des investissements étrangers,
– développement de structures dédiées à l’intelligence économique et au contre-espionnage industriel,
– prise en compte accrue du rôle des médias et de la guerre informationnelle dans la concurrence économique,
Sur le plan offensif, la réflexion stratégique française a intégré la nécessité pour les entreprises françaises de ne pas seulement renforcer leur sécurité, mais d’adopter des stratégies de conquête et d’influence :
– montée en puissance des techniques de lobbying et de soft power pour influencer les décisions internationales ;
– emploi stratégique de l’information et de la désinformation dans les batailles commerciales ;
– reconnaissance que la bataille pour l’accès aux ressources et aux technologies impose une approche proactive.
Dans cette perspective, l’École française de guerre économique a su développer des méthodes proches de celles des Américains et des Chinois, tout en adaptant ces pratiques à un cadre européen plus normatif.
Un modèle unique en Europe, mais encore perfectible
Bien que la France ait une longue tradition en matière de réflexion stratégique, sa réflexion actuelle reste confrontée à des limites et à plusieurs défis.
– Un manque de coordination au niveau européen. Malgré les efforts des chercheurs français pour faire reconnaître la guerre économique comme un enjeu majeur, la majorité des pays européens reste réticente à adopter cette vision. L’Allemagne, en particulier, est très attachée à une approche économique plus “ouverte” et moins stratégique. L’Italie, en dépit de l’existence de certains courants souverainistes proches de cette approche, n’a pas encore développé un véritable écosystème d’intelligence économique comparable à celui de la France.
– Une difficulté à passer de la théorie à la pratique. Si la réflexion française est solide, l’application concrète des principes de guerre économique reste encore trop limitée. Les entreprises françaises, malgré les efforts de sensibilisation, restent souvent vulnérables face aux offensives étrangères.
– Un besoin de moderniser l’approche face aux nouvelles menaces. La guerre économique ne concerne plus seulement l’industrie classique, mais aussi le numérique, la cybersécurité, la guerre de l’information et l’intelligence artificielle. L’école française de guerre économique devra intégrer plus profondément ces nouvelles dimensions pour rester pertinente face aux défis du XXIe siècle.
*
L’approche française de la guerre économique est sans doute la plus élaborée d’Europe, en grande partie grâce aux travaux de figures comme Harbulot, et d’autres chercheurs engagés dans cette réflexion. Elle se distingue par une vision réaliste et proactive du conflit économique, loin de la naïveté qui caractérise encore certains États européens.
Toutefois, cette approche devra évoluer pour intégrer pleinement les nouvelles dimensions de la guerre hybride, où la frontière entre guerre militaire, économique et informationnelle est de plus en plus floue.
En ce sens, l’Italie pourrait tirer des enseignements précieux de l’expérience française, en développant à son tour une véritable doctrine nationale d’intelligence économique et de protection stratégique de ses intérêts. Car dans un monde où la compétition ne se limite plus aux armes classiques, seuls les États qui sauront maîtrisés
Prise d’armement pour essais du patrouilleur outre-mer Jean Tranape
Direction : Marine
Le 5 mars 2025 à Boulogne-sur-Mer, le vice-amiral d’escadre Christophe Cluzel (ALFAN), a présidé la cérémonie de prise d’armement pour essais (PAE) du patrouilleur outre-mer (POM) Jean Tranape.
Cette cérémonie a débuté par la première levée des couleurs, signe visible de son passage sous statut de bâtiment de combat. ALFAN a ensuite fait reconnaître le capitaine de corvette Romain Montevil comme premier commandant du Jean Tranape et lui a confié le fanion de l’unité. C’est l’acte de naissance de l’équipage d’armement, désormais officiellement reconnu comme le premier équipage du Jean Tranape.
Jusqu’à l’automne 2025, le bâtiment restera à Boulogne-sur-Mer, dans les chantiers de Socarenam. Il ira ensuite à Brest pour réaliser des essais à la mer. Son arrivée à Nouméa est prévu au premier semestre 2026. Pleinement intégré au contrôle étatique et aux essais, l’équipage d’armement progresse ainsi dans la connaissance du bâtiment et se prépare à sa prise en charge.
Remplaçant les patrouilleurs de type 400 tonnes (P400), les patrouilleurs outre-mer sont à destination de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et de La Réunion. Ces nouveaux patrouilleurs disposent d’une autonomie et d’une élongation accrues afin de couvrir les vastes ZEE de nos territoires d’outre-mer. À terme, six patrouilleurs outre-mer viendront renforcer les moyens maritimes en océans Indien et Pacifique pour assurer des missions de souveraineté : surveillance des abords maritimes, police des pêches, lutte contre le narcotrafic, missions de sauvetage… Le Jean Tranape, quatrième de série, sera basé en Nouvelle-Calédonie, sa devise est « J’ai la baraka, il m’arrivera rien ».
Le nom de ce patrouilleur outre-mer rend hommage à Jean Tranape, compagnon de la Libération, originaire de Nouvelle-Calédonie. Né en 1918 à Nouméa, il s’engage comme volontaire en 1940 et participe notamment aux combats de Bir-Hakeim, de Libye, de Tripolitaine, de Tunisie, d’Italie et de Provence. Il sera blessé à plusieurs reprises, notamment au cours de la libération de Toulon. Il décède en 2012.
Dassault Aviation envisage de produire jusqu’à cinq Rafale par mois
par Laurent Lagneau
En novembre dernier, le chef d’état-major de l’armée de l’Air [CEMAEE], le général Jérôme Bellanger, avait expliqué que le don de Mirage 2000-5F à l’Ukraine allait « percuter le format de l’aviation de chasse » et avoir un « effet sur l’usure des Rafale », ceux-ci devant voler davantage. « Le ministère [des Armées] l’a compris et on regarde comment on peut pallier cette cession », avait-il dit.
Or, il n’y a pas trente-six solutions pour remédier à cette cession de Mirage 2000-5F [voire au retrait anticipé des appareils restants]. Et la seule possible consisterait à accélérer la livraisons des quarante-deux Rafale F4 commandés par la Direction générale de l’armement [DGA] à Dassault Aviation au titre de la 5e tranche production. Et cela alors que l’industriel doit également honorer les commandes à l’exportation [Serbie, Indonésie, Émirats arabes unis, etc.].
En 2024, le PDG de Dassaut Aviation, Éric Trappier, avait indiqué que deux Rafale sortaient des lignes d’assemblage de l’usine Mérignac tous les mois. Et d’annoncer que le rythme allait s’accélérer dans les mois à venir.
« Nous passons d’une cadence, qui était quasiment inférieure à un en 2020, où cela devenait vraiment critique, à une cadence 3. Aujourd’hui, nous sommes à cadence 2 », avait en effet déclaré M. Trappier, avant de souligner les « difficultés récurrentes » rencontrées par la chaîne des sous-traitants [la « supply chain »].
Un an plus tard, à l’occasion de la présentation des résultats de Dassault Aviation pour l’exercice 2024, M. Trappier a fait le point sur cette montée en puissance.
« La chaîne de fabrication part des pièces primaires d’un ensemble de 500 sous-traitants pour arriver à Mérignac, où on assemble les avions avant de les livrer. Nous sommes passés à la cadence 3 en ce qui concerne l’amont. […] À Mérignac, qui est donc à la fin du cycle, il faut un certain temps pour monter en puissance, d’autant que l’on fait face à certaines difficultés de la ‘supply chain’. On a livré vingt-et-un Rafale en 2024 et on va en livrer vingt-cing en 2025. Il y a une montée d’un demi point de cadence, à peu près, entre 2024 et 2025 », a expliqué le PDG de Dassault Aviation.
Cela étant, il est question d’aller plus loin. Depuis maintenant plusieurs semaines, le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, prépare les esprits à hausse significative de l’effort de défense. Une orientation confirmée par le président Macron, lors de son allocution télévisée du 5 mars. A priori, selon les dernières déclarations du locataire de l’Hôtel de Brienne, le budget des armées « pourrait atteindre un poids de forme convenable autour de 90 milliards d’euros par ans » [contre un peu plus de 50 milliards en 2025, ndlr].
Le mois dernier, à l’antenne de BFMTV et dans les pages du quotidien « Le Parisien », M. Lecornu a avancé qu’il faudrait probablement trois frégates de premier rang de plus et ajouter une trentaine de Rafale au format de l’aviation de chasse.
Aussi, Dassault Aviation entend se préparer à une nouvelle commande de Rafale pour les besoins de l’AAE ainsi qu’à d’éventuels nouveaux contrats à l’exportation.
« On anticipe le passage à la cadence 4, déjà. Et s’il le fallait, on envisagerait le passage à la candence 5. Évidemment, sous réserve d’avoir des commandes », a affirmé M. Trappier.
Par ailleurs, s’agissant de l’exportation, Dassault Aviation attend la signature par l’Inde d’une commande portant sur vingt-six Rafale Marine… tout en espérant aussi aussi remporter l’appel d’offres que New Delhi doit bientôt lancer pour se procurer cent quatorze avions de combat [programme MRFA]. En cas de succès, l’industriel français envisage d’installer une chaîne d’assemblage dédiée au Rafale sur le sol indien.
Quoi qu’il en soit, a rappelé M. Trappier, monter en cadence « ne se fait pas en claquant des doigts. C’est un travail qui se planifie ». Ce qui prend du temps : il faut en effet compter « au moins deux ans » pour « gagner un point de cadence », selon lui. « On y travaille sérieusement et on essaie d’anticiper si on en sentait le besoin, ne serait-ce que pour fournir nos propres forces armées », a-t-il conclu.
Mobilisation générale : qui serait appelé sous les drapeaux ?
En cas de conflit de haute intensité, certaines tranches de la population française pourraient être mobilisées pour aller combattre sous les drapeaux.
par Cédric Bonnefoy
Après le discours d’Emmanuel Macron sur la situation très instable de l’Europe, la question commence à se poser : qui pourrait être, demain, mobilisé en cas de conflit de haute intensité ? Tout est déjà prévu.
Quelle mobilisation demain dans l’armée française ?
L’hypothèse d’un conflit de haute intensité mettant en jeu la sécurité nationale soulève la question de la mobilisation militaire et civile. Depuis la suspension du service militaire en 1997, l’armée française repose sur un modèle professionnel, mais la législation prévoit toujours la possibilité d’une mobilisation générale en cas de nécessité absolue.
Avec plus de 151 000 militaires d’active répartis entre l’armée de Terre, la Marine nationale et l’armée de l’Air et de l’Espace, les forces opérationnelles constituent le premier rempart en cas de conflit. Ces effectifs, immédiatement mobilisables, incluent 77 000 soldats pour l’armée de Terre, 34 000 marins et 40 000 aviateurs, selon un rapport parlementaire sur le budget 2022 de la Défense. À ces troupes s’ajoutent environ 33 700 réservistes opérationnels, dont 22 000 pour l’armée de Terre, 6 000 pour la Marine et 5 700 pour l’armée de l’Air et de l’Espace. Le ministère des Armées rappelle que « notre modèle de défense repose sur la dissuasion nucléaire et la capacité d’engagement du chef de l’État en tout temps et en tous lieux pour défendre les intérêts vitaux de la nation »
Si ces forces ne suffisent pas, des renforts pourraient être envisagés parmi les anciens militaires récemment libérés du service et formés au combat. La question d’une mobilisation plus large, incluant la population civile, se pose alors.
La mobilisation générale, un cadre juridique existe
Bien que non décrétée depuis 1939, la mobilisation générale reste une option prévue par le Code de la défense aux articles L2141-1 à L2141-4. Elle permettrait d’affecter une partie ou la totalité des citoyens à un poste à finalité militaire. Cette mesure exceptionnelle ne peut être décidée que par décret en Conseil des ministres, signé par le président de la République.
En cas de crise grave mettant en péril l’existence même de la nation, le service militaire obligatoire pourrait donc être rétabli. Cependant, contrairement aux mobilisations de 1914 et 1939, où chaque homme connaissait son affectation grâce à son livret militaire, l’organisation actuelle rend ce scénario difficilement applicable. L’absence de formation militaire chez la majorité des citoyens et le manque d’infrastructures pour les accueillir compliqueraient une mobilisation massive.
Si la mobilisation devait être élargie, elle concernerait prioritairement les hommes âgés de 18 à 45 ans, catégorie historiquement appelée sous les drapeaux. L’une des problématiques majeures serait logistique. À la veille de la Première Guerre mondiale, la France comptait huit millions d’hommes mobilisables. En 1939, ce chiffre s’élevait encore à 4,5 millions. Aujourd’hui, la mise en place d’un tel dispositif poserait des défis considérables en termes d’équipement et d’encadrement.
Autre point d’évolution majeur : la place des femmes. Si elles étaient exclues des mobilisations générales des conflits passés, leur rôle dans l’armée française est désormais bien établi. Avec un taux de féminisation de 17 %, parmi les plus élevés au monde, elles seraient aussi concernées par une mobilisation d’ampleur.
Rheinmetall démos sur un véhicule blindé de génie Kodiak aux forces terrestres polonaises
Peter Felstead
Rheinmetall Landsysteme a démontré les capacités de son véhicule blindé AEV 3 Kodiak (AEV) aux Forces terrestres polonaises, a annoncé la société le 6 mars 2025.
Le véhicule a été présenté à la conférence des commandants du Corps des ingénieurs polonais le 26 février à la zone d’entraînement militaire d’Ostrowo Krzyckie.
Après avoir démontré pour la première fois la mobilité, l’accélération et la vitesse de l’AEV 3 Kodiak dans divers terrains, Rheinmetall a ensuite montré le véhicule effectuant des tâches typiques du corps du génie, qui impliquent de soutenir les mouvements amicaux et d’inhiber les mouvements ennemis. Pour ce faire, il a utilisé son bras de pelleteuse, qui est monté au centre du véhicule, et sa pale de bulldozer.
Les avantages du concept de bras central du véhicule ont été démontrés car il a d’abord creusé un fossé antichar, puis réparé un barrage d’inondation endommagé. Le point culminant de la démonstration, selon Rheinmetall, a été lorsque l’AEV 3 Kodiak a surmonté le fossé anti-tank précédemment creusé.
L’AEV 3 Kodiak est actuellement le seul nouveau véhicule ingénieur blindé basé sur le châssis de char de bataille principal Leopard 2 et son groupe motoréducteur: un diesel MTU 873 Ka-501 V-12 qui développe 1 103 kW couplé à une transmission Renk HSWL 354. Outre la Bundeswehr, qui a chargé Rheinmetall de fournir 44 AEV 3 Kodiak au printemps 2021, le véhicule est exploité par les Pays-Bas, Singapour, la Suisse et la Suède.
Les Forces terrestres polonaises, quant à elles, exploitent actuellement une demi-douzaine d’AEV MID Bizon, qui sont basées sur le châssis du PT-91: le plus ancien type de MBT de la flotte de chars des forces terrestres polonaises.
Dans ses manifestations polonaises, Rheinmetall a également montré comment l’AEV 3 Kodiak peut être converti en un système de déminage blindé connu sous le nom de Keiler Next Generation (NG). La société offre cette capacité à la fois comme une variante personnalisée ou via un kit d’extension de déminage comprenant une charrue de mine Pearson, le système de cordon de détonation assisté par fusée Plofadder, un duplicateur de champ magnétique et un système de marquage de la voie de mine.
La charrue de la mine de Pearson, qui a une largeur de plus de 4 m, peut éliminer les mines à une vitesse allant jusqu’à 250 m par minute sur un sol meuble, tandis que pour opérer sur un sol ferme, le système Rheinmetall Denel Munaving Salesofadder peut couper un chemin de 160 m de long et 9 m de large à travers les champs de mines et les obstacles en quelques minutes.
Au lieu d’un bras d’excavatrice, le Keiler NG dispose d’une grue intégrée afin qu’il puisse effectuer des changements de réaménagement, de suivi ou de changement d’outil de manière indépendante. Pour l’autoprotection, l’AEV 3 Kodiak et le Keiler NG portent le système de protection de Kodiak de Kodiak de type AEV 3 et le système d’armes télécommandé de Natter 12,7 mm.